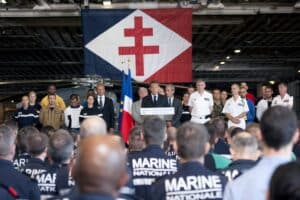Chaque trimestre, l’Audace! publiera un long entretien avec un artiste autour d’une même question : qui ont été vos figures tutélaires (célèbres ou non) qui ont façonné votre personnalité ? Pour ce premier numéro, André Manoukian nous a semblé être le candidat idéal. Parce que son caractère est aussi généreux que la musique qu’il compose, et parce qu’il est un formidable passeur de savoirs.
Propos recueillis par Natacha Polony et Emmanuel Tellier
L’Audace! : Nous sommes tous le fruit de rencontres. La première de ces rencontres, c’est celle avec une terre, son lieu de naissance. D’où venez-vous, André Manoukian ?
André Manoukian : Je suis né à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Cette ville, c’est Benjamin Biolay qui en parle le mieux : il a fait fort en chantant « Je suis entre la colline qui prie et la colline qui crie ». Celle qui prie, c’est Fourvière ; celle qui crie, c’est la Croix-Rousse, la colline des canuts. Et chantée par Biolay, ce n’est pas une formule, c’est de la poésie ! Qui dit beaucoup de choses à propos d’une ville pourtant pas facile à saisir. Parce que, quand tu rencontres un gars qui te dit « Je suis de Lyon », en général, tu fais « Ah, d’accord… » – et là, grand silence… Quand tu es musicien, tu n’as qu’une envie : quitter cette ville. Et pourtant on l’aime, parce qu’elle a l’âme italienne ; parce que Saint-Jean, c’est magnifique ; et parce qu’elle a plutôt bien vieilli. Chaque fois que j’y retourne, je me dis : « Oh là là, que c’est beau ! » Mais quand tu as 18 ans et que tu rêves d’une vie d’artiste, tu te sens comme Lucien de Rubempré chez Balzac : tu te dis que la vie est ailleurs.
L’A! : Est-ce qu’une certaine identité lyonnaise – l’histoire ouvrière de la ville, l’âme des quartiers populaires – a pu forger votre tempérament ?
AM : Oui, parce que la Croix-Rousse, ça a toujours été la colline réfractaire, un peu foutraque. On y fréquentait un restaurant associatif qui s’appelait Chez Maryvonne, où on mangeait pour rien du tout, c’était un refuge pour les familles. Et puis, il y avait ces fameuses « traboules », qui permettaient de passer d’une rue à l’autre en coupant à travers les immeubles, ce qui était pratique quand tu te faisais courser… Le Lyon que j’ai connu était archi populaire. Avec mes copains, on louait des appartements à des prix très modestes, et pourtant les plafonds étaient à quatre mètres. C’étaient des immeubles habités par les canuts, avec leurs grands métiers à tisser la soie. À 18 ans, j’ai eu mes premiers locaux de répétition dans le même quartier. La scène locale était plutôt rebelle et rock, avec Rachid Taha, Carte de séjour, Starshooter. Ça ne m’emballait pas trop, parce que je me voyais plutôt en jazzman… Mais pour revenir en arrière, je dois dire que je me suis un peu ennuyé pendant toute mon enfance. Parce que Lyon, comme Bordeaux, est une ville bourgeoise, avec des clans ; or c’est difficile d’entrer dans un clan. En fait, j’aurais dû naître dans un quartier chic, dans une clinique du VIe arrondissement, mais ce soir-là, paraît-il, c’était la pleine lune [rires]… Donc je suis né à la Croix-Rousse, ce qui me va très bien.
L’A! : Vos premiers souvenirs de musique, les premiers sons, c’était quoi ?
AM : C’est le son du piano. Il y en a toujours eu un à la maison, mon père en jouait tous les jours. Toute sa vie, il a été tailleur pour dames, avec son mètre ruban autour du cou, pendant que ma mère tenait la boutique. Mon père a été obligé de tirer l’aiguille dès l’âge de 12 ans. Pourtant, il voulait faire tout sauf ce métier… Son drame, c’est que son père, mon grand-père, consacrait tout son temps à la communauté arménienne – il était arrivé en France en 1923. Donc mon père, se sentant délaissé, s’est construit ses « humanités » tout seul, et c’est là que la France arrive dans notre conversation, dans toute sa splendeur, à travers cet amour incroyable que mon père a porté à « ses » poètes, ses philosophes, ses écrivains, jusqu’au dernier jour de sa vie ! À 95 ans, il me récitait encore des poèmes de Baudelaire, ou alors il me disait : « André, on n’a pas assez travaillé aujourd’hui, va sur mon bureau, tu verras ce que j’ai préparé. » Et là, j’y trouvais un texte de Montaigne, et nous devions le lire ensemble. Montaigne, qui est devenu fondamental pour moi comme pour mon père.
« Mon premier maître de vie a été mon père. N’ayant pu aller à l’école, il s’était façonné une culture d’autodidacte. »
Mon premier maître de vie a donc été ce tailleur pour dames qui, n’ayant pu aller à l’école, s’était façonné une culture d’autodidacte, avec une soif de savoir inextinguible. De cette époque me reviennent les premiers vers de L’Horloge, de Baudelaire : « Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible. Dont le doigt nous menace et nous dit : “Souviens-toi !” » Quand j’entends ça, je pense à mon « rep ». Qui, au fond, s’est construit toute cette culture pour échapper au récit du drame arménien. Il faut se remettre dans le contexte : mon grand-père, à Lyon, était une référence pour toute la communauté. Le chemin était le même pour tous ceux qui avaient fui le génocide : dès qu’un Arménien arrivait dans une ville, en France ou ailleurs, la première chose qu’il faisait, c’était de construire une église. Puis les suivants, qui sont arrivés entre les années 1930 et les années 1960, demandaient : « Où est l’église arménienne ? » En y allant, ils étaient immédiatement pris en charge. Or, à Lyon, on leur disait : « Allez chez Manoukian ! » Et ça, mon père en a souffert : ça lui faisait mal de voir son paternel sortir sans cesse, donner ses économies planquées dans le piano à des inconnus ; et finalement assez peu prendre soin de son propre fils.
Plus tard, Boris Cyrulnik m’a expliqué ça : « Un enfant est beaucoup plus traumatisé par ce qu’il entend que par ce qu’il voit. » Je crois que c’est ce qui est arrivé à mon père : c’est pour fuir le passé et les récits de sa communauté qu’il s’est construit son refuge, dans les mots, dans les idées, avec Platon, Montaigne, Rabelais – mais aussi avec Friedrich Schiller et Goethe, mon père étant germaniste. Et je dois à cet homme épris de culture universaliste mon propre tempérament, mon appétit – d’autant plus que j’ai eu le bonheur d’hériter de sa bibliothèque. Je lui dois aussi mon amour pour le piano, puisqu’il en jouait quotidiennement, là encore pour s’évader. Il aimait jouer les Inventions de Bach, et ça, c’est ma madeleine de Proust.
L’A! : Parlons de ce piano. En la matière, et particulièrement en musique française, qui ont été vos grands maîtres, ceux dont vous avez le plus appris ?
AM : Il faut d’abord rappeler que la musique française est la plus orientale de toutes. Ravel, Debussy, Fauré, Chabrier : ils ont tous été chercher des influences venues d’ailleurs et, pour moi, cela fait partie de leur génie, et d’un certain génie français. Beaucoup ont profité de l’Exposition universelle de 1889, un choc pour les yeux et les oreilles ! À cette époque, la tendance, dans toute l’Europe, c’est d’aller chercher le « sel » du territoire – c’est pour ce genre d’expression que j’adore Gilles Deleuze, qui a si bien expliqué à quel point le territoire produit une musique. Cette quête de sel, c’est Bartók qui va dans les campagnes hongroises, ou les compositeurs russes qui s’inspirent de chants populaires des campagnes – même Stravinsky a fait ça.
Mais le génie des Français, c’est de se tourner vers l’ailleurs. Ravel et Chabrier incorporent des sons venus d’Espagne. Debussy se tourne vers l’Orient. Et cette route musicale va nous mener vers la musique la plus expressionniste qui soit : cette musique française à cheval sur deux siècles, colorée d’une sorte de spleen assumé que je trouve formidable. Et pourtant, j’ai longtemps détesté l’excès de mélancolie, aussi fort qu’Elia Kazan la détestait – Kazan parlait du « sourire anatolien » de son père, une posture d’endurance qu’il détestait, car c’est un sourire qui disait « tout va bien » alors que la souffrance était partout… Mais le spleen, c’est autre chose, c’est plus subtil, plus doux. Aujourd’hui, la mélancolie ne me dérange plus, au contraire. Elle est d’ailleurs très présente dans la musique arménienne, que j’ai découverte tardivement. Et ce que le spleen permet, chez Ravel, Chabrier et Debussy, c’est de gommer l’exubérance. Il y a dans leur musique une forme de politesse : je tourne autour des notes, je ne vais pas directement au do – oh non, ce serait trop facile ! –, alors je l’esquive, je passe par le ré, le mi, le si.
L’A! : Amoureux de cette musique française, vous décidez pourtant de traverser l’Atlantique à l’âge de 20 ans. Pour visiter le pays qui a vu naître le jazz ?
AM : Oui, je m’inscris à Berklee, la grande école de musique de Boston. Et là, je comprends ce qu’être français veut dire. Je le comprends par l’absurde, en étant confronté à la superficialité de mes camarades américains. Le premier jour, je croise un grand gars qui me dit : « Hi, my name is John. » Je lui réponds : « Hi, my name is André. » Et ce gars, comme tous ses potes, va me dire bonjour tous les matins, avec un grand sourire, mais la relation n’ira jamais plus loin que ça. Parce que la plupart de ces gens sont incultes ! Et absolument pas curieux des autres, ou de l’ailleurs. La moitié des Américains n’ont pas de passeport, ils ne quittent jamais le pays. Alors, pour discuter avec eux, ça limite les choses… C’est depuis ce pays que j’ai compris en quoi nous, Français, avions une culture, un rapport au passé, un patrimoine, qui nous tient et nous unit. Même quand tu n’as que 20 piges, tu as lu des auteurs, tu connais des musiques, des chansons populaires, tu as ce passé qui vibre en toi.
« Nous, Français, sommes bien plus proches psychiquement des Russes que des Américains. »
Plus tard, j’ai retrouvé ce sens de la culture qu’on trimballe avec soi dans un autre pays, la Russie – c’est pour ça que ce qui se passe en ce moment me désole, parce que nous, Français, sommes bien plus proches psychiquement des Russes que des Américains, mais bref… Donc mon passage par Boston fut une révélation « à l’envers ». J’y ai aussi compris que nous sommes français dans l’art de la diatribe, dans ce plaisir d’être dans les cafés, de débattre, d’argumenter pendant des heures. Voilà qui nous ramène à Gilles Deleuze, ce philosophe qui compte tant pour moi. Au début des années 1970, il a posé le concept de « déterritorialisation », qui dit qu’un territoire ne vaut que quand il est quitté. Dans mon cas, c’était flagrant : je me suis senti vraiment français après avoir quitté mon pays, ma culture. Et quand tu as compris ça, je te jure, la France, elle te manque. J’ai retrouvé une lettre envoyée de Boston à mes parents, ma première lettre de là-bas, et je leur disais : « Vous savez, chers parents, en France, on vit dans un beau pays, avec de belles valeurs. »
L’A! : À Boston, vous avez étudié le jazz, dont les esthétiques et la liberté continuent d’irriguer votre écriture. Pour vous, y a t-il une façon française de jouer cette musique, et si oui, quels en sont les maîtres ?
AM : Réponse spontanée : Martial Solal, qui est une invention purement française, un jazz un peu cérébral, mais attention, magnifique ! J’ajouterai quelques génies, Michel Legrand, immense mélodiste, mais aussi, en allant vers la pop, Michel Colombier, Jean-Claude Petit, Jean-Claude Vannier… Mais la figure qui domine cette galaxie est apparue plus tôt, et cette femme qui a le mieux incarné « une idée française de la musique », c’est Nadia Boulanger. Et là, on est au sommet !
La preuve, c’est que cette pédagogue de génie – dont la sœur, Lili, était compositrice, exercice pour lequel Nadia se sentait moins douée – a donné des cours aux plus grands musiciens du monde entier : Bernstein, Gershwin, Schifrin, Piazzolla, ils accouraient tous en France pour grandir à ses côtés ! Boulanger enseignait dans une école américaine, à Fontainebleau, et ça lui a permis d’être libre ; elle n’était pas enfermée dans le programme du Conservatoire. Elle a été l’amie de Ravel, de Stravinsky. En plus d’un savoir technique considérable, elle semblait avoir saisi « l’âme de la musique ». Pour moi, elle reste une grandiose source d’inspiration, un repère, une invitation à la liberté… Une anecdote : vous savez pourquoi Quincy Jones, qui avait fait ses classes dans les orchestres de Lionel Hampton puis de Dizzy Gillespie, est venu apprendre les arrangements pour cordes auprès de Nadia Boulanger, en France, à partir de 1957 ? Parce qu’à cette époque, les Noirs américains n’avaient pas le droit de toucher à ces instruments « classiques » réservés aux Blancs ! Ce qui veut dire que sans Nadia, il n’y aurait pas eu toutes ces sublimes parties de violons et de cordes dans les albums de Michael Jackson ! Merci Nadia ! [rires]
L’A! : Est-ce que cette forme de « génie français » que vous décrivez-là – un état d’esprit, en même temps qu’un positionnement physique, mental et sensible, à la croisée des mondes – continue à s’exprimer aujourd’hui ?
AM : Cet état d’esprit a été très puissant dans les années 1980-1990 avec ce qu’on a appelé, à Paris, la « sono mondiale », promue par Radio Nova, et par un type épatant, connu comme un ami des musiciens partout sur la planète : Rémy Kolpa-Kopoul – un autre de mes héros français. À l’époque, tous les artistes d’Amérique latine ou d’Afrique rêvaient de venir jouer en France, notre pays les faisait rêver… Est-ce qu’on a perdu ça ? Oui, sans doute, en partie. C’est pour ça qu’on a besoin de bons directeurs artistiques dans les maisons de disques.
Je voudrais en citer un, car la musique française lui doit beaucoup : Emmanuel de Buretel [ex-patron de Virgin et Delabel, désormais à la tête de Because]. À la fin des années 1980, il a eu l’idée incroyable de pousser Les Négresses Vertes, issues de la scène alternative parisienne, à jouer à fond le côté « java » dans leur musique. À l’époque, je me demandais souvent : comment faire pour que la musique française rayonne à l’international, sans juste copier les Anglais ou les Ricains ? Eh bien, Buretel a trouvé la réponse : tu prends un rythme propre à la France, la java, et tu en fais un truc un peu punk. Immense succès des Négresses Vertes en Grande-Bretagne ! Une leçon.
L’A! : Et dans le domaine de la chanson, de qui vous sentez-vous redevable ?
AM : J’ai de l’admiration pour les grands paroliers. En France, ce sont les textes qui font la richesse de notre patrimoine – davantage que les musiques. D’ailleurs, le public français est surtout touché par les textes, c’est ça qu’il mémorise. Ce côté « les chansons racontent nos vies », on l’a tous vécu ! J’en ai fait l’expérience après une rupture amoureuse, un truc difficile, et là, j’entends à la radio : « Dites-moi même qu’elle est partie pour un autre que moi. Mais pas, à cause de moi… » [Dites-moi, de Michel Jonasz, 1974]. Démonstration parfaite : la chanson me parlait de mon chagrin, et elle m’a fait un bien fou…
« Bien sûr, la reine, c’est Gréco. C’est une star avant même d’être connue. »
Dans le même registre, Un jour, tu verras, de Mouloudji, peut me faire chialer. Et puis, bien sûr, la reine, c’est Gréco. Quand tu la vois à 20 ans, la Juliette, tu as l’impression qu’elle est née pour faire ça : artiste, chanteuse, muse. C’est une star avant même d’être connue. Elle vit dans des petites chambres de Saint-Germain, elle porte des pantalons parce qu’elle n’a rien d’autre à se mettre, des gars les lui ont prêtés, et elle arbore cette drôle de frange parce qu’elle s’est coupé les cheveux seule dans sa piaule.
Un jour, en interview, je lui parle de sa relation à Sartre, et donc elle me parle de ses 20 ans. De sa voix grave, elle me dit : « J’étais une gamine et je sortais avec Merleau-Ponty, qui avait deux fois mon âge. Qu’est-ce qu’il dansait bien ! » [Rires] Puis elle me raconte qu’un soir, ils dansaient au Bal-Nègre, et que du balcon surplombant la piste, une grosse voix a résonné. C’était Sartre, jaloux : « Merleau, qu’est-ce que tu fous avec la petite ? » En fait, tous les intellos et les musiciens se disputaient Gréco, qui les fascinait. Pour tenter de la reconquérir, Sartre lui a écrit une chanson… qu’elle n’a jamais chantée ! Quand il lui a demandé ce qu’elle en pensait, elle a répondu : « C’est long… »
Le nouvel album d’André Manoukian, La Sultane, vient de paraître (chez PIAS). Il sera en tournée en France au printemps.