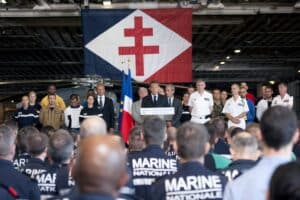Propos recueillis par Gérald Andrieu
Depuis de Gaulle, le monde arabe a changé. Il faut parfois faire avec des acteurs non étatiques, des organisations islamistes, etc. Quant aux États qui pèsent sur la scène internationale, ils se trouvent désormais dans le Golfe. Sans oublier que, sous Emmanuel Macron, explique l’ancien ambassadeur Bertrand Besancenot, désormais reconverti dans le secteur de l’intelligence économique et de l’influence, la diplomatie française ne s’est pas toujours montrée très cohérente…
L’Audace! : Qu’est-ce qui a poussé le général de Gaulle à creuser le sillon de ce qu’on nommera « la politique arabe » de la France : sa volonté d’indépendance et de non-alignement, ou y a-t-il quelque chose de plus pragmatique qui se jouait ?
Bertrand Besancenot : Le général de Gaulle était un homme extrêmement pragmatique. Une fois la question algérienne réglée et l’affaire de Suez quelque peu oubliée, il a estimé qu’il était dans l’intérêt de la France de mener une politique de coopération avec des pays avec lesquels nous avions des liens forts, des relations étroites et anciennes : les pays du Maghreb, le Liban, la Syrie, mais aussi ceux du Golfe.
Nous avions des intérêts économiques, évidemment, mais aussi diplomatiques. Quand on est membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, il est important d’avoir des « amis » avec lesquels on peut mener des opérations. L’Arabie saoudite, par exemple, avait rompu ses relations diplomatiques avec nous lors de la guerre d’Algérie. Il était tout à fait logique de reprendre langue avec ce pays. D’ailleurs, la visite à Paris du roi Fayçal d’Arabie saoudite, en 1967, a visiblement donné de bonnes raisons au Général de décider, à l’époque, de mettre un embargo sur les exportations d’armes à Israël.
À lire aussi : De Gaulle et les liquidateurs de la politique arabe de la France
C’est à cette période que notre image dans la région a complètement changé. Nous avons été perçus comme un pays à la fois « ami des Arabes », avec une position plus équitable que les autres États occidentaux sur la question palestinienne – qui reste, dans l’opinion publique arabe, la cause sacrée de la région –, et avec une diplomatie plus indépendante à l’égard de Washington.
« Le Quai d’Orsay a toujours eu une certaine attention à l’égard de ce qu’on appelle “la rue arabe”. »
L’A! : Il est une autre expression, la « rue arabe », à laquelle, dit-on, le Quai d’Orsay aurait toujours prêté une oreille attentive. Est-ce si vrai ?
BB : Le Quai d’Orsay et la direction d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (ANMO) ont en effet toujours accordé une certaine attention à ce qu’on appelle la « rue arabe ». Par exemple, lors des printemps arabes, on a vu une sorte de « romantisme révolutionnaire » en son sein, qui témoignait de la présence encore forte de cette sensibilité. Cela étant, au Quai d’Orsay, il y a toujours eu des débats – et c’est sain – entre la direction ANMO et la direction des affaires stratégiques qui, elle, avait une vision plus atlantiste.
Cette attention à la « rue arabe » est propre au Quai d’Orsay car le ministère de la Défense, lui, a une sensibilité différente. Il a traditionnellement conservé des relations de coopération avec Israël, notamment en matière de renseignement. J’ai pu le constater lorsque j’étais conseiller diplomatique de la ministre Michèle Alliot-Marie.
L’A! : L’arrivée de Nicolas Sarkozy à l’Élysée a-t-elle marqué une rupture, comme on le dit souvent ?
BB : Très clairement, oui. Si on passe en revue les successeurs de De Gaulle, nous pourrions résumer ainsi. Pompidou, c’était la suite, ça va de soi. Giscard d’Estaing avait une vision planétaire, mais sur la politique moyen-orientale, il est resté assez largement dans la norme. Mitterrand, au départ, comme de nombreux socialistes français, avait un prisme plus pro-israélien. Néanmoins, après l’invasion israélienne au Liban en 1982, il a eu une sorte de « réflexe gaullien », si je puis dire, vis-à-vis de Yasser Arafat. Il est donc perçu dans ces régions comme étant lui aussi, même partant d’un prisme différent, un héritier de la politique du Général. Avec Chirac, pas besoin de le détailler, on a même eu le sentiment d’un retour à la geste gaullienne.
« Le roi Abdallah a dit au président Sarkozy : “Même les étalons sauvages ont besoin de quelqu’un pour en tenir les rênes.” »
À l’arrivée de Nicolas Sarkozy – j’avais été nommé à Riyad peu avant –, on m’a demandé d’assister à une réunion entre lui et le roi Abdallah d’Arabie saoudite. Le président Sarkozy, très habilement, a tout de suite démarré en disant : « Sire, je sais que certains vous ont dit que je ne m’entendais pas avec le président Chirac, votre ami, et, d’autre part, que j’étais pro-américain et pro-israélien. Je vais vous répondre sur ces différents sujets. Mon objectif, c’est de faire en sorte que nous parvenions à la même complicité que celle que vous aviez avec le président Chirac. » À la fin de l’échange, le roi Abdallah a eu ces mots : « Monsieur le président, on m’avait dit effectivement tout cela de vous. En vous écoutant, je suis frappé par votre énergie, je comprends pourquoi les Français ont voté pour vous. Mais croyez le vieux monsieur que je suis. Vous êtes un étalon sauvage et, chez nous, dans le monde arabe, on dit que même les étalons sauvages ont besoin de quelqu’un pour en tenir les rênes. » Sarkozy a très bien réagi. « Je suis très honoré d’être votre étalon sauvage, a-t-il répondu. Je sais que vous êtes le sage de la région. Je vous promets que je ne prendrai pas d’initiatives sans vous en avoir parlé d’abord. » On sait ce qu’il en a été : en 2008, notamment, Nicolas Sarkozy a invité, au titre de l’Union pour la Méditerranée (UpM), Bachar Al-Assad à Paris, ce qui a rendu furieux le roi Abdallah…
L’A! : L’UpM, initiée par Nicolas Sarkozy, n’était-ce pas pour le coup une judicieuse idée ? Une telle organisation n’aurait-elle pas été utile et même salutaire après le 7 octobre ou au vu de nos relations exécrables avec Alger ?
BB : Oui, c’était plutôt une bonne idée. Mais elle a été mal conçue. J’étais alors en poste dans le Golfe. J’avais dit à Paris : « Si vous voulez que l’on vende ce projet à nos autorités, qu’elles y participent, encore faut-il savoir ce que vous leur proposez en retour. » Et la réponse qui m’avait été faite était : « Il faut qu’elles financent l’UpM. » Ce qui m’a paru un peu inattendu et même offensant. Il y avait donc comme un vice de fabrication à l’origine de l’UpM. Sans oublier d’autres aspects comme, par exemple, les mauvaises relations entre le Maroc et l’Algérie.
L’A! : La politique arabe de la France ne s’est-elle pas tout bonnement fracassée sur deux phénomènes : d’abord, les printemps arabes, qui ont redessiné la carte de cette zone du monde et l’ont même perturbée durablement en changeant le visage et la nature de plusieurs de nos interlocuteurs ; ensuite, la poussée islamiste et, plus particulièrement, les attentats qui ont frappé notre pays ?
BB : Il n’y a pas de politique étrangère qui ne tienne pas compte de la politique intérieure. Ce qui m’a frappé après les attentats de novembre 2015, c’est ce qu’on pourrait appeler le mood des responsables politiques et des commentateurs français, qui ont tapé sur l’Arabie saoudite et le Qatar. Il y avait une forme de facilité, de commodité, à cela. Certes, il y a eu quelques financements issus de ces pays, mais c’est assez minime. Ce ne sont pas ces États qui ont frappé la France. Ce ne sont pas de chez eux que viennent les imams radicalisés, mais de Turquie, d’Algérie, de Mauritanie. C’est sans doute lié à l’image que les Français ont des États du Golfe : des pays monarchiques, religieux, riches. En somme, tout ce qu’on déteste en France !
À lire aussi : La politique arabe de la France naufragée sur l’éperon de l’islamisme
Reste qu’après les printemps arabes, le centre de gravité du monde arabe s’est déplacé à l’est, précisément dans ces pays-là. Car ils sont à la fois des pôles de développement et de stabilité. Aujourd’hui, le principal interlocuteur de Donald Trump dans la région est Mohammed ben Salman, le prince héritier saoudien. Et, accessoirement, Mohammed ben Zayed, le président des Émirats arabes unis. Si on veut influer sur Benyamin Netanyahou pour essayer de créer une perspective de stabilité et régler la question palestinienne, il n’y a que Trump qui puisse le faire. Et la seule personne que Trump écoute réellement, c’est Ben Salman. Tout simplement parce que le président américain rêve du prix Nobel de la paix, notamment en obtenant que l’Arabie saoudite reconnaisse Israël – ce qui entraînerait d’autres pays du monde arabo-musulman sur cette voie. Enfin, il veut aussi décrocher des contrats juteux dans le Golfe. C’est aussi simple que cela.
L’A! : Revenons un instant au changement de nature de nos interlocuteurs. De Gaulle pouvait dialoguer avec des chefs d’État comme Ben Gourion ou Nasser. Aujourd’hui, il faut parfois faire avec le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, les Frères musulmans, etc. Doit-on et peut-on dialoguer avec ce genre de personnes ? Et peut-on espérer obtenir quoi que ce soit d’acteurs parfois non étatiques ?
BB : Nous devons distinguer ceux qui pratiquent le terrorisme, comme le Hamas, que nous devons combattre ; et ceux dont nous ne partageons pas forcément les orientations mais qui ont une certaine représentativité dans la région et avec qui nous devons conserver un dialogue critique, comme le Hezbollah, les Houthis ou les Frères musulmans, pour faciliter la recherche de solutions afin d’apaiser les tensions dans la région.
L’A! : Sur Gaza, Emmanuel Macron a débuté avec une position assez absurde, en annonçant vouloir monter une coalition internationale pour combattre le Hamas, comme avait été combattu Daesh. Qu’aurait-il fallu faire au lendemain du 7 octobre ? Et la reconnaissance de l’État de Palestine par la France a-t-elle eu un quelconque poids ?
BB : Sous Emmanuel Macron, la diplomatie française dans le monde arabe a pas mal tergiversé. On ne peut vraiment pas parler d’unité de la « politique arabe de la France » sous sa présidence…
Pour notre président, le modèle du monde arabe, voire musulman, c’est Mohammed ben Zayed. À la fois parce que les Émirats sont un succès économique incontestable et parce que, d’autre part, Ben Zayed se veut le fer de lance de la lutte contre l’islam politique. Cela a duré pendant tout le premier quinquennat et a été mal perçu par le Qatar et l’Arabie saoudite, pour des raisons évidentes. Depuis, Emmanuel Macron a fait des gestes en direction de ces pays-là.
De la même façon, au Liban, l’Élysée a soutenu de façon très curieuse la candidature de Sleiman Frangié à la présidence, alors que 90 % des chrétiens ne voulaient pas en entendre parler et que c’est un homme au profil pour le moins contestable, proche de Bachar Al-Assad. Depuis, on a rectifié le tir en soutenant la candidature de Joseph Aoun.
« Au moment du 7 octobre, le président Macron a donné le sentiment d’être “à côté de la plaque”. »
Au moment du 7 octobre, il y a encore eu des tergiversations de la part d’Emmanuel Macron, notamment ce projet de coalition internationale qui était contraire au bon sens. Avec cette proposition surréaliste, il a donné le sentiment d’être lui-même « à côté de la plaque ». Ensuite, on a eu l’impression que la France embrassait toute la propagande israélienne. Puis on a tenu un discours plus ferme à l’encontre de Netanyahou et on a pris la très bonne initiative franco-saoudienne sur la solution à deux États.
Le président aurait dû faire avec Israël ce qu’il a fait au Liban, après l’explosion du port de Beyrouth en août 2020 : il aurait dû, dès le 8 octobre 2023, se rendre sur place pour manifester la sympathie et le soutien du peuple français à Israël. Ce qui nous aurait sans doute donné plus de latitude ensuite pour nous montrer critiques. Car il y a bien un problème avec Benyamin Netanyahou : son gouvernement a toujours joué la politique du pire en privilégiant le Hamas, autre tenant de la politique du pire, plutôt que de dialoguer avec l’Autorité palestinienne, et il a poursuivi la colonisation de la Cisjordanie dans le but de l’annexer.
Est-ce que la reconnaissance de la Palestine par la France a eu un « poids » ? D’abord, nous aurions dû le faire plus tôt. Le plus important, en réalité, c’est qu’on ait pris l’initiative de travailler avec les Saoudiens sur ce sujet, et cela pour la raison que j’ai indiquée précédemment : ils sont les seuls que le président Trump écoute vraiment dans la région.
L’A! : N’a-t-on pas fait preuve du même genre de tergiversations avec l’Algérie ? Emmanuel Macron a joué l’Algérie à fond, dès sa campagne de 2017, en décrivant la colonisation comme un « crime contre l’humanité », puis a changé son fusil d’épaule en supportant à fond le Maroc, en allant même jusqu’à reconnaître la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental.
BB : Je pense que la France a été beaucoup trop timorée envers l’Algérie. Nous avons des intérêts majeurs avec ce pays, qui sont également des intérêts humains et culturels. Mais on n’est pas obligé de subir les caprices de la junte militaire en place. L’approche du président Macron, qui a commencé par faire du mémoriel, n’était pas forcément la meilleure. Quand vous avez en face de vous des généraux qui sont tout sauf des gens ayant un affect profond, on négocie d’une autre façon.
Je pense qu’on peut parfaitement tenir un langage de vérité aux uns et aux autres. Dans la vie internationale, l’important, c’est d’être respecté. Il faut le dire : le fait que nous soyons aujourd’hui un pays très endetté, que nous ayons tergiversé dans beaucoup de dossiers et que notre politique ait parfois pu être arrogante, notamment en Afrique, tout ceci n’a pas amélioré notre crédibilité sur la scène internationale.
« Considérant qu’il était extrêmement intelligent, le président Macron a concentré les pouvoirs. Ses ministres des Affaires étrangères n’ont pas réellement eu droit à la parole. »
L’A! : Ce qui joue sans doute aussi, dans notre manque de crédibilité, c’est que nos ministres des Affaires étrangères ont l’air de n’être plus que des super-VRP parcourant le monde pour remplir les bons de commande de notre industrie d’armement sans chercher une quelconque cohérence diplomatique…
BB : Ce que je crois surtout, c’est qu’Emmanuel Macron, considérant qu’il était extrêmement intelligent et brillant, a totalement concentré les pouvoirs dans ses mains, notamment en matière de politique étrangère. Ses ministres des Affaires étrangères n’ont pas réellement eu droit à la parole, ils étaient juste des « gestionnaires ». Quand on personnalise à ce point la relation, ce n’est pas très bon. Parce que les hommes ont tous des travers, le président ne fait pas exception. Et cela a des inconvénients qui vont avec cette personnalisation…
L’A! : Évoquons le cas de Boualem Sansal. Comment aurait-il fallu agir d’entrée de jeu avec Alger ?
BB : Dans ce genre d’affaires, dès qu’on en vient aux accusations publiques, les gens s’abritent derrière leur amour-propre et on ne règle rien. La seule chose qui fonctionne en ce domaine, c’est la discrétion. On peut s’appuyer notamment sur un envoyé spécial. Je vous donne un exemple : quand j’étais en Arabie saoudite, du temps de Laurent Fabius, décision avait été prise que chaque fois qu’il y avait une exécution publique, le porte-parole du Quai d’Orsay la condamnait. Et, à chaque fois, j’étais convoqué par les autorités saoudiennes. J’allais prêcher la bonne parole sur les méfaits de la peine de mort et, à la fin, on m’expliquait : « Ce que Dieu nous a donné comme instruction est plus important que les conseils de nos amis. » On a décidé de changer de méthode : nous avons arrêté les condamnations systématiques des exécutions et, parfois, nous avons très discrètement remis des lettres du président Hollande au roi ou à son fils aîné demandant une grâce royale. Et on en a obtenu plusieurs.
L’A! : Ce qui fait la beauté de la France, mais peut-être aussi son handicap sur le plan des relations diplomatiques, c’est ce projet républicain et universaliste, puisque nous prônons des valeurs – la France des droits de l’Homme – face à des interlocuteurs qui ne les partagent pas nécessairement et font même parfois preuve de beaucoup plus de cynisme que nous…
BB : Il y a une sorte de dichotomie entre le discours français et la réalité du pays. Nous passons notre temps à faire la morale. Si nous étions un modèle de réussite, je voudrais bien. Mais nous ne le sommes pas. Avec les grands discours, on se fait plaisir. À la fin, c’est notre comportement qui compte et qui peut faire avancer les choses. Le modèle que nous présentons au monde est aujourd’hui un modèle d’instabilité, de pagaille, d’endettement massif : tout ça ne fait pas de la France un produit très vendable à l’étranger. Le surréalisme, ça a du bon dans l’art, pas en politique.
L’A! : Que devrait faire, selon vous, le prochain président en matière de « politique arabe » ?
BB : Je ne sais pas si l’expression « la politique arabe de la France » signifie encore quelque chose. Mais nous pourrions avoir des objectifs clairs dans trois domaines. Premièrement, concernant le conflit israélo-palestinien, il faut tenir sur la solution à deux États parce que ça reste, comme je le disais, la cause sacrée des opinions publiques arabes – moins des gouvernements, sans aucun doute. Deuxièmement, il faut veiller à ce que nous accordions une place particulière à des pays qui ont des liens culturels et humains forts et anciens avec nous, comme le Maghreb, le Liban ou la Syrie. Avec de la fermeté. Parce que, entretenir de bons rapports avec ces États-là, ça n’implique pas d’avoir une politique en matière d’immigration aussi laxiste que la nôtre. Troisièmement, il faut renforcer nos relations avec les pays du Golfe car, aujourd’hui, qu’on le veuille ou non, ils sont devenus le centre de gravité du monde arabe : ce sont eux qui offrent des opportunités économiques et commerciales ; ce sont eux qui reconstruiront à la fois la Syrie, le Liban et la Palestine. Le tout, en conservant des relations fortes avec l’Égypte, puisque ce pays reste le cœur du monde arabe.