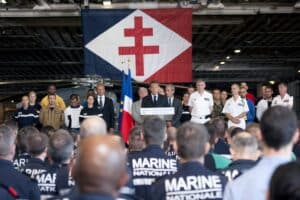Il y a quarante ans, la France rivalisait avec les plus grandes puissances économiques mondiales. Du Concorde au TGV, en passant par les centrales nucléaires et les télécommunications, notre pays rayonnait. Puis certains ont commencé à expliquer qu’il fallait donner le plus de compétences possibles au privé. Résultat : par idéologie, l’État a été affaibli, saccagé…
Février 2025. Alors que les États-Unis et la Chine investissent des fortunes dans l’innovation en matière d’intelligence artificielle, Emmanuel Macron organise un sommet sur l’IA à Paris. La raison officielle ? « Rattraper notre retard » dans cette nouvelle révolution industrielle. Il en ressortira l’annonce de 109 milliards d’euros d’investissements… par des entreprises américaines et émiraties pour entraîner leurs propres modèles sur notre sol, en profitant de notre électricité peu chère et décarbonée. Cela ne créera aucun emploi en France ou presque, aura comme principal effet le renchérissement de l’électricité pour les ménages, et nous placera tout en bas de la chaîne de valeur. Devenir un gisement low cost pour les États-Unis et les pays du Golfe : quelle curieuse conception de la souveraineté !
D’où vient un tel décrochage ? Il y a quarante ans encore, la France rivalisait avec les États-Unis et l’URSS. Du Concorde au TGV, en passant par les centrales nucléaires, la recherche médicale, les télécommunications et notre système de santé publique, notre pays se plaçait en leader mondial. Qu’est-ce qui a changé ?
À lire aussi : En finir avec la désindustrialisation de l’Europe “périphérique”
Ce ne sont pas les compétences qui manquent : nous savons encore former des chercheurs et des ingénieurs… mais ils excellent dans les entreprises américaines. Serait-ce un problème de taille ? La France n’aurait pas la « taille critique », ce qui la condamnerait à un nécessaire fédéralisme européen ? Nous n’étions pas plus grands quand nous rivalisions avec les géants américain et soviétique. Sans oublier que des pays comme Taïwan, la Corée ou Singapour n’ont pas attendu d’atteindre une « taille critique » pour devenir des puissances technologiques.
Des fleurons industriels publics vendus
Si la France s’efface aujourd’hui, c’est parce qu’il n’y a plus aucun acteur qui se donne pour mission qu’elle réussisse. Car ce rôle, dans notre pays, c’était celui de l’État. Tout comme c’est le cas en Chine et aux États-Unis. L’État est le principal acteur de la puissance chinoise, bien sûr : il orchestre le ballet des entreprises privées et investit massivement dans l’éducation, la recherche et l’innovation. Mais c’est aussi le cas aux États-Unis, par le biais du complexe militaro-industriel, des commandes publiques et du soutien à la recherche. Quant à la France ? C’était le cas jusqu’aux années 1990, avec un rôle central joué par la puissance publique dans le développement économique et social, la planification, la coordination des acteurs privés…
« Notre pays, qui a su bâtir vingt centrales nucléaires en dix ans, peine aujourd’hui à en terminer une en vingt ans. »
Trente ans plus tard, la majorité de nos fleurons industriels publics ont été vendus, l’école et l’hôpital sont à bout de souffle, les services publics croulent sous le poids d’une bureaucratie nouvelle. Les annonces de plans se multiplient, mais rien ne se fait. Le pays, qui a su bâtir vingt centrales nucléaires en dix ans, peine aujourd’hui à en terminer une en vingt ans. L’attractivité de la fonction publique, qui parvenait à attirer parmi les meilleurs, est en chute libre. À force de pertes de compétences, l’État français s’est rendu de plus en plus dépendant d’acteurs privés et étrangers. Hypertrophié au sommet, impuissant dans son administration, de plus en plus absent sur le terrain, il a démissionné de ses fonctions clés, nécessaires pour faire d’un pays une puissance. Les citoyens comme les entreprises ne le rencontrent plus que comme une contrainte fiscale et réglementaire, et sont obligés de payer toujours plus cher des services de moins bonne qualité. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi la France a-t-elle sabordé l’un de ses principaux atouts ? Et comment rebâtir ?
Le ministère de l’Équipement sacrifié
En 2009, dans les bureaux du jadis puissant ministère de l’Équipement débarquent des armées de cost-cutters, consultants au sein du Boston Consulting Group ou chez Roland Berger. « Ils nous ont demandé de justifier notre utilité », témoigne un ingénieur chargé des routes, dérouté par la question. Les ordres, émanant du « patron », Nicolas Sarkozy, étaient clairs : il faut réduire les coûts en supprimant 200 000 postes de fonctionnaires. Seulement voilà, ces consultants n’ont pas frappé là où c’était nécessaire mais là où c’était le plus simple : la diplomatie, parce qu’elle est loyale ; l’armée, parce qu’elle est astreinte à un devoir de réserve ; les ingénieurs et techniciens d’État, parce que personne ne les connaît.
À lire aussi : Les dilemmes mal résolus de notre défense nationale
Le ministère de l’Équipement, doté de 120 000 ingénieurs et techniciens, est pourtant cet organe essentiel auquel nous devons nos autoroutes, nos ports, le TGV, le tunnel sous la Manche… jusqu’au viaduc de Millau, qui en fut à la fois l’une des plus belles réalisations et le chant du cygne. Un tel ministère aurait pu constituer un atout essentiel pour la France, alors que nous avons plus que jamais besoin de projets d’aménagement, de la transition énergétique à la construction d’infrastructures numériques souveraines (lire p.XX). Au détail près qu’il n’existe plus. Car les commandos, faisant penser au Department of Government Efficiency (DOGE), de Donald Trump et Elon Musk, version Nicolas Sarkozy, ont si bien coupé, supprimé, fusionné, qu’en quelques années, le ministère avait disparu. « Raisons budgétaires » obligent, même si le coût réel lié à la perte de compétences est finalement beaucoup plus élevé. Sans oublier que le nombre de fonctionnaires a finalement augmenté, mais au sein des collectivités et de l’administration intermédiaire. Raisons idéologiques, aussi, car prévalait alors la mode de la « fin de l’Histoire » : l’idée que le pays était déjà aménagé, qu’il n’y aurait plus rien à faire, que le rôle de l’État était désormais réduit à réguler, à se retirer, que le marché tout-puissant ferait le reste.
C’est cette même idéologie de « la fin de l’Histoire » qui a conduit le ministre de l’Économie Emmanuel Macron, sollicité en 2015 au moment de la vente d’Alcatel à Nokia (dernier épisode du démantèlement de notre fleuron des télécommunications), à expliquer qu’il fallait sortir de cette « vision romantique » qui consisterait à dire : « C’est une entreprise française, ne laissons personne l’attaquer, bloquons la fusion. » Ou à refuser toute intervention de l’État dans le dossier Alstom parce qu’« on n’est pas au Venezuela, ici ! ». La mondialisation libérale devait l’emporter, l’État ne devait plus avoir de rôle à jouer, tout pouvait être privatisé, même dans les services publics. Ces dogmes ont produit autant de slogans, dont beaucoup perdurent aujourd’hui, sans qu’on en ait réellement dressé le bilan.
« “Il faut gérer l’État comme une entreprise”, a-t-on martelé. Or comment mesure-t-on la rentabilité d’un service ? »
« Il faut gérer l’État comme une entreprise », a-t-on martelé. C’est-à-dire soumettre les services publics à des impératifs de rentabilité. Or comment mesure-t-on la rentabilité d’un service ? Combien « rapporte » à la collectivité une infirmière, un militaire ? On n’en sait trop rien. Tandis que l’évidence de son coût comptable, elle, est incontestable. Donc nos dirigeants, formatés dans les mêmes écoles, ont transformé la recherche d’« efficacité » en coupes budgétaires. C’est ainsi que le lycée professionnel, qui formait les techniciens et cadres intermédiaires ayant été au cœur de la modernisation de la France sous de Gaulle et la Ve République, a été saboté. Parce qu’elles nécessitent d’investir dans des machines et plateaux techniques, les formations industrielles et artisanales coûtent plus cher que les formations « générales ». Il a alors été décidé de fermer nombre de ces filières et de multiplier à la place les formations en « secrétariat-administration ». Résultat : on manque de soudeurs dans l’industrie et d’ouvriers qualifiés pour réindustrialiser le pays, et près de 60 % des élèves sortant d’un lycée professionnel ne trouvent désormais plus d’emploi. Rarement une économie budgétaire n’a coûté si cher.
L’utopie d’un « État minimal »
L’autre mot d’ordre concernait les externalisations. Donner le plus de compétences possibles au privé, au « marché », pour que l’État se recentre sur « l’essentiel ». À tel point que la puissance publique paie désormais jusqu’à 160 milliards d’euros par an à des prestataires privés. Curieuses économies à nouveau. Qui ont surtout accéléré notre dépendance et la perte de compétences en interne. Habité par l’utopie d’un « État minimal », on a supprimé de nombreux postes et débouchés en son sein : des ingénieurs, des techniciens, des experts de la maîtrise d’ouvrage.
En 2007, l’Éducation nationale lance un projet de logiciel de ressources humaines des fonctionnaires, SIRHEN, et le confie à des entreprises privées, dont Capgemini. Après 400 millions d’euros dépensés en dix ans, le projet ne débouche sur rien. La Cour des comptes est formelle : le ministère n’avait même pas les compétences en interne pour suivre ce que faisait Capgemini. En voulant passer d’un État qui fait lui-même à un État qui « fait faire », la perte de compétences est telle qu’il n’est même plus certain que l’on sache superviser. L’État en vient à externaliser jusqu’à la fabrique même des politiques publiques à des cabinets de conseil privés, dont McKinsey, donnant l’impression de ne même plus savoir déterminer par lui-même ce qu’il devrait faire.
Il s’agissait enfin de tout « privatiser », louant comme supérieure la gestion du privé. Si cela est en soi contestable – un exemple : la privatisation du rail au Royaume-Uni a été si catastrophique et a conduit à tant d’accidents qu’il a fallu renationaliser –, les privatisations ont été particulièrement coûteuses en France. Parce que l’essentiel de notre économie était centralisé dans quelques grands groupes, que l’on a commencé à vendre à partir de 1986 sous Chirac, mouvement poursuivi sous Jospin, Sarkozy et Macron, jusqu’à la privatisation de nos infrastructures comme les autoroutes ou les aéroports. Le problème est que la France n’avait pas les capitaux privés pour investir dans ces entreprises : ce sont donc des fonds étrangers qui les ont majoritairement rachetées. À tel point que, hors luxe, le CAC 40 est désormais contrôlé à plus de 60 % par des fonds étrangers, et l’actionnaire le plus important en est BlackRock.
Sans compter le manque à gagner colossal que cela constitue : Total et Elf Aquitaine ont été privatisés dans les années 1990 pour l’équivalent de 50 milliards de francs. Aujourd’hui, Total rapporte 20 milliards d’euros de bénéfices par an à ses actionnaires privés, dont Amundi. La perte est d’autant plus sèche que les recettes n’ont pas été utilisées pour constituer un fonds souverain, qui aurait pu permettre à l’État d’investir dans d’autres secteurs, mais pour financer chaque année le déficit courant. Tout l’argent lié à nos actifs perdus s’est aujourd’hui évaporé.
Trahison d’une partie des grands corps
On aurait pu s’arrêter en si mauvais chemin. On aurait pu faire un premier bilan, se rendre compte qu’on était en train de saboter notre outil économique, notre appareil industriel, notre puissance publique. Mais le pouvoir en France est trop concentré entre les mains de quelques-uns. C’est tout le drame de notre système, qui a confié à quelques « grands corps d’État » – ENA, X-Mines, X-Ponts – la charge de l’intérêt général. Que ceux-là viennent à se convertir d’une logique industrielle à une logique purement financière et court-termiste, et c’est le système entier qui s’effondre.
Cette trahison des grands corps, ou plutôt d’une frange d’entre eux, est à l’origine d’un grand nombre de nos défaites politiques et industrielles. La déroute d’EDF, les faillites ou ventes d’Alstom, de Thomson, d’Alcatel, d’Atos proviennent de ces grands commis d’État qui ont abandonné l’intérêt national, parfois au profit d’un enrichissement rapide ou de postes dans le secteur privé, mais le plus souvent par idéologie. Qu’une minorité contrôle le pouvoir, cela a toujours existé. Seulement, cette minorité a décidé que le système français était désuet, obsolète, qu’il fallait le remplacer en imitant notamment les Anglo-Saxons, en s’inspirant de l’idéologie reagano-thatchérienne et d’un New Public Management mal digéré.
« Les recettes du succès de la Silicon Valley sont beaucoup plus proches de ce qui se faisait en France sous de Gaulle que de la “start-up nation” macronienne. »
Le plus ironique, c’est que les États-Unis ne fonctionnent pas réellement ainsi. Le Royaume-Uni, comme nous, s’est fait avoir et a bien de la peine aujourd’hui à s’en remettre. Mais jamais les États-Unis n’ont réellement affaibli leur État ni même l’ont retiré des affaires courantes. L’illusion, c’est que nous avons moins cherché à imiter les recettes réelles du succès américain que l’image qu’ils nous en ont donné, leur storytelling. L’exemple de la « start-up nation » le montre bien. Ce qui devient clair avec Donald Trump était vrai depuis longtemps : la Silicon Valley est initialement un projet étatique, lancé par l’État fédéral américain, l’État de Californie et l’armée américaine dans les années 1950 en pleine guerre froide.
Encore aujourd’hui, les pouvoirs publics sont omniprésents, tant pour financer l’innovation que par les commandes publiques qui nourrissent les Gafam. Les recettes réelles du succès de la Silicon Valley sont beaucoup plus proches de ce qui se faisait en France avec le complexe militaro-industriel gaullien que de la « start-up nation » macronienne. Cela est enfin visible et connu de tous : Trump intervient massivement dans l’économie américaine, à travers des investissements, des obligations pour les grands groupes d’investir à domicile plutôt qu’à l’étranger, des prises de participation dans des entreprises stratégiques – 10 % dans Intel. Cela conduira-t-il enfin à un réveil de notre côté ?
Sortir du fatalisme
On parle de plus en plus de « souveraineté », on se remet à parler « d’État stratège », parfois même de « planification ». Mais c’est de la communication politique. Dans le fond, rien ne se fait. Nos entreprises continuent à être vendues, et quand les médias alertent, Bpifrance intervient pour prendre 1 % du capital aux côtés de l’acheteur étranger pour « blanchir » l’image de la transaction sans que cela change rien. La folie est que l’on continue à défendre qu’il faudrait « moins d’État », d’Édouard Philippe au milliardaire ultraconservateur Pierre-Édouard Stérin, en passant par le désormais célèbre Louis Sarkozy. Sans jamais faire le bilan de pourquoi les recettes proposées ont pour l’instant produit l’effet inverse, c’est-à-dire une explosion des dépenses publiques et une perte d’efficacité.
Sans jamais se dire qu’à force de saboter notre capacité d’action collective et le seul acteur qui doit penser sur le long terme, on finira par devenir effectivement des nains, vassalisés, à la merci d’intérêts privés et des États étrangers demeurés, eux, puissants.
Alors, que faire ? Il est avant tout urgent de sortir du fatalisme. La principale cause de notre perte de puissance n’est pas exogène ou inévitable. Elle est liée à une succession de choix volontaires, qui produisent ensemble un effet frappant : il n’y a plus aucune institution en France capable, aujourd’hui, de réellement prévoir le temps long et d’agir pour nous y préparer. Alors que se multiplient les défis colossaux, il faut retrouver un État qui s’autorise à investir réellement, à arrêter de saborder les services publics, l’éducation, la recherche, pour des gains de court terme.
L’avantage, c’est que le délitement de l’État est relativement récent. Il faut donc apprendre de nos succès passés. Nous avons encore un fort capital humain, un savoir-faire industriel, un parc nucléaire et hydroélectrique bridé mais existant. La France ne manque pas de talents, elle manque d’une puissance publique qui croit encore en eux et en sa mission.
La véritable bataille est surtout dans les mentalités : il faut rompre avec l’idée que le modèle français serait intrinsèquement défectueux et qu’il faudrait en imiter d’autres. Les grandes puissances économiques mondiales – les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Allemagne, l’Inde – ont toutes des modèles différents. Leur principal point commun est d’avoir su partir de la situation réelle de leur pays, de leurs véritables forces et faiblesses, pour bâtir un modèle d’avenir adapté, en confiant à l’État la mission de redresser le pays et d’attirer les meilleurs pour le servir. C’est ce qu’il nous reste à faire si l’on veut espérer demeurer une puissance au XXIe siècle.