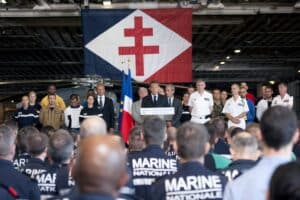Définir le type de guerre qui pourrait advenir est encore le meilleur moyen de s’y préparer, d’en amoindrir les effets ou, tout bonnement, de l’éviter. Les décisions prises depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par la Russie doivent être étudiées de près. Pour, demain, ne pas être pris à revers, prévient le Général Durieux.
Dès le premier chapitre de son œuvre majeure, De la guerre (ouvrage inachevé publié en 1832), Carl von Clausewitz formule cet avertissement : « Le premier, le plus important, le plus décisif acte de jugement qu’un homme d’État ou un commandant en chef exécute consiste alors dans l’appréciation correcte du genre de guerre qu’il entreprend, afin de ne pas la prendre pour ce qu’elle n’est pas et de ne pas vouloir en faire ce que la nature des circonstances lui interdit d’être. » (1) Cette mise en garde, qui concerne d’abord les pays engagés dans des opérations militaires, aurait gagné à être méditée par nombre de chefs d’État occidentaux de ce début du XXIe siècle, comme en témoignent les échecs enregistrés en Irak ou en Afghanistan. Vladimir Poutine aurait lui-même dû lui prêter encore plus d’attention. Mais elle prend une autre ampleur si on l’applique à la conception d’une politique de défense. Celle-ci, avant de prévoir budgets, équipements ou systèmes d’alliances, devrait toujours partir d’une appréciation correcte du genre de guerre ou de défi géopolitique auquel elle doit préparer.
C’est à l’aune de cette considération qu’il faut relire la façon dont la défense française a été pensée et organisée depuis la Deuxième Guerre mondiale et, plus particulièrement, depuis la fin de la guerre froide, au tournant des années 1990, pour pouvoir envisager l’avenir. L’appréciation correcte du « genre de guerre » auquel se préparer a conduit à donner alternativement la priorité à deux grands objectifs stratégiques. À certaines époques, il s’est agi de se préparer à la guerre, au sens classique du terme, face à une éventuelle invasion venue de l’Est. À d’autres périodes, la guerre semblant une perspective moins palpable, l’objectif a consisté à promouvoir notre puissance en s’appuyant sur les notions de rang, de statut ou d’autonomie stratégique. Ces priorités changent en moyenne tous les trente ans, mais la transition est loin d’être aisée et il a fallu en général une quinzaine d’années pour modifier notre posture stratégique à chaque fois que l’évolution du contexte l’imposait.
Armes atomiques
Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en dépit de la guerre froide naissante, la priorité est à la restauration du rang auquel notre pays avait prétendu au lendemain de sa victoire dans la Grande Guerre. La tentative de préservation de notre présence en Indochine, notre contribution à la guerre de Corée, l’intervention à Suez – avec des alliés britanniques eux-mêmes préoccupés par leur déclin – et l’engagement militaire massif en Algérie illustrent à la fois une certaine relativisation de la menace d’invasion et, par-delà les aléas de la IVe République, notre souhait d’asseoir notre rang au sein du monde libre. Ceci se traduit par la reconstruction des armées françaises en fonction de leurs engagements lointains – la marine française, notamment, est reconstituée grâce aux crédits du Mutual Defense Assistance Act américain, corollaire du plan Marshall.
En 1958, l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle et l’avènement de la Ve République correspondent à un changement de priorité stratégique. Si l’enjeu d’affirmation de puissance ne disparaît pas, il s’incarne d’abord dans la construction d’une capacité crédible et autonome de défense du territoire face à la menace d’une invasion soviétique. C’est le moment où la France va se doter des armes atomiques, suivant la terminologie de l’époque, dans une période où celles-ci sont d’abord envisagées pour leurs vertus tactiques dans le cadre d’une bataille en Europe, avant de revêtir peu à peu leur dimension stratégique (2).
Notre préoccupation d’autonomie se traduit, en 1966, par le retrait de l’organisation militaire intégrée de l’Alliance atlantique. Les armées françaises sont priées de se préparer à nouveau à la guerre symétrique et de laisser derrière elles les réflexes de la guerre contre-révolutionnaire. Cette transition ne se fait pas sans douleur et l’effet de ciseau lié à la nécessité de financer la nouvelle stratégie de dissuasion et la baisse des crédits – on passe de 5,44 % du PIB en 1960 à 2,45 % en 1974 – se traduit par la paupérisation des forces conventionnelles qui sera rendue évidente au milieu des années 1970, notamment avec l’apparition des comités de soldats.
Le char Leclerc est conçu à partir de 1978, le premier sous-marin nucléaire d’attaque de la classe Rubis entre en service en 1983 et le Rafale effectue son premier vol en 1986.
Au bout de quinze ans, néanmoins, la capacité opérationnelle des armées françaises va s’affirmer. Sur le plan de la doctrine, le livre blanc sur la défense de 1972 propose une articulation étroite des stratégies nucléaire et conventionnelle. Les septennats de Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) et de François Mitterrand (1981-1988) sont marqués par un nouvel effort budgétaire qui atteint près de 3 % du PIB en fin de période, ce qui permet la conception d’équipements majeurs destinés à la bataille contre les armées du Pacte de Varsovie. Le char Leclerc est conçu à partir de 1978, le premier sous-marin nucléaire d’attaque de la classe Rubis entre en service en 1983 et le Rafale effectue son premier vol en 1986.
La France retrouve donc une certaine crédibilité militaire au moment où la désagrégation de l’Union soviétique bouleverse à nouveau le contexte stratégique. La guerre disparaît des horizons des stratèges au profit de l’attrait des « dividendes de la paix », suivant l’expression popularisée par Laurent Fabius. La recherche de la puissance va progressivement repasser au premier plan de nos priorités, et les notions de rang relèguent les considérations opérationnelles à la marge des débats stratégiques. C’est à cette époque que sont faits les trois grands choix qui structurent encore aujourd’hui notre appareil de défense, à la faveur du livre blanc de 1994, de l’annonce de la professionnalisation par Jacques Chirac en 1996 et de la loi de programmation militaire qui suit (3).
Trois choix décisifs
Le premier choix concerne notre dispositif militaire. Il est celui d’une armée polyvalente, à la fois chargée de faire face à la résurgence d’une menace majeure et de contribuer sur le mode expéditionnaire à la police internationale par des opérations extérieures, souvent conduites dans le cadre du maintien de la paix. Simultanément, isolée de sa dimension conventionnelle, devenue largement « existentielle », la dissuasion nucléaire repose de manière croissante sur la seule détention d’armes dites « stratégiques », la notion d’armes tactiques étant bannie. Ce qui se traduit à partir de la présidence de Jacques Chirac par des discours de défense portant uniquement sur la dissuasion et visant avant tout à affirmer le maintien de sa pertinence dans un monde qui ne semble plus devoir craindre la guerre. La dissuasion et les forces dédiées aux opérations extérieures (OPEX) deviennent donc d’abord des instruments de puissance visant à permettre à la France d’assumer son statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.
Le deuxième choix, en partie corollaire du premier, a trait à l’équilibre entre le format de nos forces et celui de la sophistication – et donc le coût de nos équipements. La professionnalisation de nos armées se traduit par une réduction massive de leur volume : le choix de conserver toutes les capacités propres à un modèle d’armée dit « complet » signifie en réalité un modèle échantillonnaire. Ce choix permet cependant de soutenir les bureaux d’études de l’industrie de défense. On commande peu d’équipements – la « cible » de chars Leclerc à produire passe ainsi de 1 500 à 406 –, mais on préserve la possibilité de conserver une industrie au meilleur niveau technologique à l’horizon de vingt ans, un choix qui a du sens, au moins rétrospectivement, dans une situation où un affrontement majeur en Europe ne semble plus à l’ordre du jour. Le développement continu des services de renseignement, vu comme la condition de notre autonomie stratégique, est au service de la stratégie de puissance beaucoup plus que de notre capacité à faire la guerre.
Durant la première guerre du Golfe, la France ne peut engager qu’une petite division au prix de réorganisations acrobatiques pour éviter d’avoir recours aux appelés du contingent.
Enfin, le troisième choix concerne le territoire national. La notion de « défense opérationnelle du territoire » passe au second plan et l’armée de Terre, en particulier, cède la place à la gendarmerie qui prend une place croissante. De nombreux territoires deviennent des déserts militaires, sans aucune garnison… Ce changement de perspective se révèle douloureux pour les armées françaises. Les acquis de la période précédente sont mal adaptés à la nouvelle donne. Nous en faisons les frais : d’abord, durant la première guerre du Golfe, où la France ne peut engager qu’une petite division au prix de réorganisations acrobatiques pour éviter d’avoir recours aux appelés du contingent ; puis, en Bosnie, où un certain idéalisme du maintien de la paix se heurte au réalisme de miliciens serbes qui, eux, font la guerre. Les équipements qui entrent peu à peu en service ont été conçus durant la période précédente et sont des merveilles de technologie mais s’ils sont peu nombreux, ils sont coûteux à entretenir et se révèlent mal adaptés à des opérations qui vont progressivement passer du maintien de la paix à la contre-insurrection.
Réduction du volume de nos forces
Au bout de quinze ans, autour des années 2005, le moment aurait été venu de réinvestir. Mais le capital laborieusement constitué grâce à l’élan des années 1980 va être peu à peu consommé à cause de l’usure rapide des équipements dans les opérations extérieures et l’attrait pour les « dividendes de la paix » évoqués précédemment qui, conjugué à la crise financière des années 2008, écrase les budgets. Les quelques exploits tactiques réalisés pour libérer des otages ou protéger des régimes africains masquent mal les échecs stratégiques enregistrés dans des opérations qui, en Afghanistan et, plus tard, au Sahel, auraient nécessité des unités terrestres et aériennes plus nombreuses et équipées de matériels moins coûteux mais adaptés à la contre-guérilla. Simultanément, la capacité de ces armées à la haute intensité devient très théorique.
Ce mouvement de réduction du volume de nos forces va cependant se poursuivre alors que les attentats du 11 septembre 2001 semblent confirmer l’idée de la fin des guerres majeures. Cela se traduit en France par l’importation du concept américain de sécurité nationale à la faveur de la parution du livre blanc de 2008, parachevant ainsi l’installation dans le débat d’un supposé continuum sécurité-défense concomitant de l’effacement largement fantasmé des frontières et de la péremption de la guerre. Un certain flou s’installe, dont témoigne encore la partie législative du code de la défense, où l’on peine à saisir l’articulation des concepts de sécurité nationale, de défense nationale, de défense militaire et de défense civile. Du flou au questionnement sur l’utilité des armées, il n’y a qu’un pas : les livres blancs de 2008 puis de 2013, combinés aux effets de la révision générale des politiques publiques (RGPP) décidée en 2007, conduisent ainsi à une réduction massive du contrat opérationnel des armées, accompagnée de la suppression de 54 000 postes budgétaires. Ce contrat, qui prévoit ce que les armées doivent être capables d’engager en opération, passe ainsi de 50 000 hommes et 100 avions de combat en 1994 à 30 000 hommes et 70 avions en 2008 puis 15 000 hommes et 45 avions en 2013, avec une force navale également déclinante. Globalement, le modèle reste celui qui a été décidé au milieu des années 1990 mais réduit à l’état de « bonzaï », suivant l’expression du moment (4).
Les attentats de 2015, d’abord, font apparaître l’incapacité de l’armée de Terre à déployer suffisamment d’unités sur notre propre territoire.
Il faut cette fois moins d’une quinzaine d’années pour que plusieurs événements servent de révélateurs aux limites de ce modèle, fruit de notre incapacité à « apprécier correctement le genre de guerre » qui se profilait. Les attentats de 2015, d’abord, font apparaître l’incapacité de l’armée de Terre à déployer suffisamment d’unités sur notre propre territoire, alors que la gendarmerie, transférée au ministère de l’Intérieur et dont les forces mobiles ont été réduites par la même RGPP, ne dispose pas de réserve. Au-delà des effectifs, l’absence de toute unité militaire sur de grandes parties du territoire national se fait durement sentir lorsqu’il faut déployer les unités Sentinelle ou planifier la réaction à d’autres événements du type « Bataclan ». Enfin, les débats récurrents sur le service national universel (SNU) et sur l’intérêt de l’ancien service militaire traduisent a minima le sentiment diffus que les armées ne sont plus en état de remplir un rôle social qui leur avait été implicitement attribué depuis la fin du XIXe siècle.
L’agression russe contre l’Ukraine de 2022 illustre ensuite avec force les limites d’un dispositif militaire écartelé, sous couvert de polyvalence, entre la réalité d’interventions extérieures fréquentes face à des insurrections rugueuses, mais légèrement armées, et le souci de conserver une capacité sérieuse de haute intensité. L’illusion de la polyvalence s’est transformée en constat de nos insuffisances, tant sont différentes les exigences d’un conflit contre un État et celles d’opérations de stabilisation. La nécessité de disposer de volumes de forces significatifs apparaît ainsi comme une des grandes leçons de la guerre en Ukraine, avec la domination des drones, qui doivent eux-mêmes être disponibles en très grand nombre. Ces forces doivent en outre pouvoir s’engager pour de longues durées, ce qui impose aussi l’accroissement des stocks de munitions et de pièces détachées. Aujourd’hui, l’armée de Terre pourrait déployer deux ou peut-être trois brigades, pour quelques mois. Rappelons qu’une brigade, en fonction du terrain et de la situation tactique ne saurait s’engager sur plus de dix à quinze kilomètres de front… À l’autre extrémité du spectre, nous avons perdu des savoir-faire liés aux interventions dans des zones d’État failli, qu’il serait présomptueux de croire révolues.
Limites de la solidarité transatlantique
L’élection de Donald Trump en 2024 et le comportement du nouveau président ont révélé les limites croissantes de la solidarité transatlantique sur laquelle nous avons, sans toujours l’assumer, beaucoup compté. Nous avions intériorisé la garantie américaine et considéré que les États-Unis resteraient solidaires dans le domaine de l’export d’armement ou du soutien de certains des équipements que nous leur avons achetés – drones, catapultes du porte-avions ou avions radars, par exemple. La restauration de notre autonomie s’annonce comme un défi redoutable.
Enfin, ce qu’illustrent à la fois les événements en Ukraine et au Moyen-Orient, c’est que, si la guerre réapparaît, c’est moins sous la forme de la menace d’un conflit mondial et unique, du type de ceux du XXe siècle, que dans sa version plus limitée mais aussi plus habituelle de moyen de prédation. Elle semble être à nouveau endossée par certains acteurs comme une modalité acceptable pour atteindre des objectifs territoriaux ou étendre leur pouvoir. À cet égard, le tout ou rien qui, en dépit des subtilités de la doctrine nucléaire française, reste consubstantiel à la dissuasion semble mal adapté pour faire face à des offensives conventionnelles qui, si elles se traduisent par le déchaînement d’une grande violence, restent progressives et limitées. Le besoin qu’a éprouvé Israël de frapper l’Iran pour entraver son programme nucléaire militaire – alors même que l’État hébreu est réputé disposer de l’arme atomique et que cette arme doit a minima dissuader une agression nucléaire – illustre assez bien l’incertitude qui prévaut dans le domaine du nucléaire militaire, pas seulement chez celui que l’on entend dissuader mais aussi chez celui qui veut dissuader.
Clausewitz nous invite à « ne pas affronter l’adversaire au fleuret moucheté quand l’autre attaquera avec un sabre tranchant ».
Pour ne pas prendre la situation géopolitique pour ce qu’elle n’est pas – et ne pas vouloir faire la politique de défense que les circonstances lui interdisent d’être, comme le conseillait Clausewitz –, il nous faut donc porter une appréciation correcte sur les défis qui pèsent sur notre défense et prendre les mesures appropriées. Après les trente années de guerre froide de 1960 à 1990 passées à préparer la guerre et les trente années de quête de puissance écoulées depuis 1990, un aggiornamento majeur est devenu urgent, près de quatre ans après l’invasion de l’Ukraine. Sans quoi la hausse des crédits effective depuis 2017 sera vaine. C’est ce à quoi nous engage le même Clausewitz lorsqu’il recommande « de ne pas affronter son adversaire au fleuret moucheté quand l’autre attaquera avec un sabre tranchant » (5).
Il nous faut écarter la tentation intellectuellement satisfaisante du fleuret moucheté, aujourd’hui celle de la subtilité dans la lutte des puissances, qui se pare des nouveaux atours de la lutte informationnelle, de la cybermenace ou de la confrontation dans les grands fonds marins. Ces menaces existent et ne font d’ailleurs que s’inscrire sous une forme nouvelle dans la tripartition traditionnelle des services secrets : l’espionnage, le sabotage et la subversion. Mais elles sont sans comparaison avec le risque du sabre tranchant, autrement dit celui d’une agression conventionnelle suffisamment limitée et progressive pour ignorer notre dissuasion mais suffisamment grave pour changer la face de l’Europe. Surtout si elle s’accompagnait, de manière non coordonnée, de la faillite de régions entières aux marches immédiates de l’Europe. Face à ce risque, il faut revoir nos ambitions et faire des choix. Il faut à nouveau donner la priorité à nos capacités à faire la guerre. Ce qui reste le meilleur moyen de l’éviter.
(1) De la guerre, de Carl von Clausewitz, livre I, chapitre 1.
(2) Les armes tactiques sont conçues pour cibler des objectifs militaires sur le champ de bataille ; les armes dites stratégiques sont destinées à atteindre des sites politiques, industriels ou des infrastructures vitales.
(3) Loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 et son rapport annexé.
(4) Camille Grand, cité par Romain Rosso, « Livre blanc sur la Défense : la tendance à l’armée bonzaï se poursuit », L’Express, 30 avril 2013.
(5) Carl von Clausewitz, De la guerre, livre I, chapitre 2.